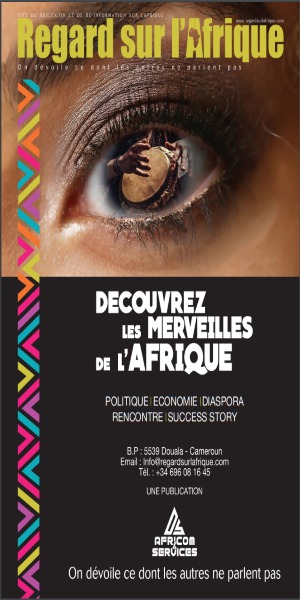La plupart des pays du continent africain ont reconnu la Palestine dans les années 1980, après la déclaration d'indépendance du dirigeant palestinien Yasser Arafat à Alger. Des dirigeants comme Thomas Sankara et Nelson Mandela ont même lié la lutte palestinienne aux luttes de libération de l'Afrique.
Le 15 novembre 1988, c'est à Alger que Yasser Arafat, le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, proclame l'indépendance de l'État palestinien dans une déclaration rédigée par le poète Mahmoud Darwich. À cette occasion, l'Algérie devient le premier pays du monde à reconnaître l'État.
Près de 80 % des membres de l'ONU reconnaissent désormais l'État de Palestine, dont la France depuis lundi. Mais près de 40 États rejettent cette idée, surtout pour des raisons de loyauté envers les États-Unis. Tour du monde des oppositions.
A contrario, au moins 39 pays n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine : les États-Unis et Israël en premier lieu. Tour d'horizon des principaux pays qui rejettent cette idée.
Le gouvernement de Benjamin Netanyahu rejette totalement l'idée d'un État palestinien et, en 2024, le parlement israélien a voté une résolution contre sa création. Le Premier ministre a répété dimanche qu'il n'y aurait pas d'État palestinien et menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie. Deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont par ailleurs appelé à l'annexion totale de ce territoire palestinien occupé.
Principal allié du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump "pense que c'est une récompense pour le Hamas" de reconnaître l'État de Palestine, a expliqué sa porte-parole, Karoline Leavitt. Comme le souligne Vincent Souriau, correspondant de RFI à Washington, les États-Unis apportent "un soutien inconditionnel à Israël" pour trois raisons principales. "Israël sert de rempart à la Maison Blanche au Proche-Orient. Dans le temps, c’était un rempart contre l’influence soviétique, aujourd’hui, c’est la lutte contre le terrorisme, la stabilité des cours du pétrole, la mise au ban du régime iranien", analyse le journaliste. Selon lui, les Israéliens sont également "les premiers testeurs" du matériel militaire américain. Enfin, c'est aux États-Unis que se trouve "la communauté juive la plus importante du monde avec près de 5,7 millions de personnes".
L'Allemagne a réaffirmé sa position selon laquelle la reconnaissance d'un État palestinien ne devrait intervenir qu'à la fin d'un processus de négociation d'une solution à deux États. "Une solution négociée à deux États est la voie qui peut permettre aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité", a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, avant son départ pour New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies. En raison de son passé nazi, l'Allemagne est, avec les États-Unis, l'un des plus fervents soutiens d'Israël, et a même fait de la sécurité de ce pays "une raison d'État" depuis 2008.
Le gouvernement ultraconservateur de Giorgia Meloni, proche idéologiquement du président américain, Donald Trump, adopte un positionnement très prudent sur la guerre à Gaza, même si la Première ministre a dit à plusieurs reprises sa "préoccupation" face à l'offensive israélienne. Rome ne veut pas reconnaître "pour le moment" l'État de Palestine et se montre réticente aux sanctions commerciales proposées par l'Union européenne envers Israël, même si le gouvernement rappelle régulièrement qu'il ne vend plus d'armes à l'État hébreu depuis le 7 octobre 2023. Selon un récent sondage de l'institut Only Numbers, 63,8 % des Italiens jugent "extrêmement grave" la situation humanitaire à Gaza, et 40,6 % souhaitent la reconnaissance d'un État palestinien.
Avant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a annoncé que son pays ne reconnaîtra la Palestine que si une série de conditions sont remplies. Les critères incluent la libération des otages israéliens, le désarmement du Hamas et son exclusion d'un futur gouvernement de Gaza. Ils exigent également la poursuite des réformes de l'Autorité palestinienne et la création d'un État palestinien démilitarisé. "C'est aux Palestiniens de fournir ce qui est nécessaire pour une reconnaissance danoise", a-t-il résumé.
Dans la même veine que les Danois, les Néerlandais ont annoncé qu'ils souhaitaient reconnaître un État palestinien, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts à le faire. "Les Pays-Bas reconnaîtront un État palestinien ultérieurement, dans le cadre d'un processus politique qui doit commencer dès maintenant", a affirmé le ministre des Affaires étrangères par intérim, David van Weel, lors d'une conférence aux Nations unies, sans s'engager sur un calendrier précis. Il a aussi rappelé que les Pays-Bas soutiennent une solution à deux États et que la violence devait cesser.
Le Japon ne reconnaîtra pas pour le moment un État palestinien, et le Premier ministre démissionnaire Shigeru Ishiba n’assistera pas à une réunion connexe lors de l’Assemblée générale des Nations unies ce mois-ci, a rapporté la semaine dernière le quotidien Asahi Shimbun, citant des sources gouvernementales anonymes. Comme le résume le journal La Presse, le Japon est "traditionnellement prudent sur les sujets qui fâchent". Le quotidien québécois rappelle également que "la politique étrangère du Japon est alignée sur celle des États-Unis depuis les années 1950". "Tokyo ne voudrait surtout pas se mettre son partenaire américain à dos en traversant ce qui est considéré comme une ligne rouge par Washington, surtout dans un contexte de négociations houleuses sur les droits de douane".
Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a réaffirmé le 18 septembre à la ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin, le soutien continu de Séoul à une "solution à deux États". À l'image du Japon, la Corée du Sud ne veut pas créer de conflits avec Washington en pleine négociation sur les droits de douane. "Depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée [1950-1953], l’alliance du Japon et de la Corée du Sud avec les États-Unis constitue la pierre angulaire de leur architecture sécuritaire. Pour Washington, tout changement dans le statut des Palestiniens doit passer par des négociations directes entre Israël et la Palestine, dans le respect du cadre d’une solution à deux États. Le Japon et la Corée du Sud ne font que suivre", a ainsi analysé auprès du journal Le Monde Adel Abdel Ghafar, du Conseil du Moyen-Orient pour les affaires internationales.
Cinquante-deux des 54 pays du continent africain ont déjà reconnu l'État palestinien. Seuls le Cameroun et l'Érythrée ne l'ont pas fait.
Le Cameroun est fortement impliqué auprès d'Israël.
Selon le site Afrik, Yaoundé "campe sur son refus" en raison notamment de "calculs sécuritaires" alors que se rapproche l'élection présidentielle lors de laquelle Paul Biya va briguer un huitième mandat : "Depuis les années 2000, la sécurité intérieure camerounaise repose en grande partie sur la Brigade d’intervention rapide, force d’élite placée sous l’autorité directe de la présidence. Créée et longtemps commandée par d’ex-officiers israéliens, la BIR bénéficie d’un entraînement, d’équipements et de systèmes de surveillance fournis par Tel-Aviv".
David Otto, directeur de la défense au Centre d'études stratégiques et de sécurité africaines de Genève, affirme qu'Israël considère le Cameroun comme l'un de ses plus puissants alliés en Afrique.
« Le Cameroun ne peut pas se permettre de compromettre ses relations diplomatiques avec Israël », affirme Otto.
Il affirme que cette relation est profonde et repose principalement sur la sécurité.
« Israël a contribué et continue de contribuer énormément à la protection du régime camerounais », affirme-t-il.
Israël a formé et serait toujours impliqué dans les forces d'intervention rapide du pays, ainsi que dans l'unité spéciale assurant la sécurité personnelle du président.
« La relation que le Cameroun a établie avec Israël a ensuite permis au Cameroun de bénéficier d'un soutien indirect des États-Unis, qui sont également un allié très proche d'Israël sur tous les fronts. »
La position du Cameroun sur la Palestine pourrait également être influencée par ses propres difficultés dans les régions anglophones. « Reconnaître l'État palestinien exercerait une certaine pression au sein du pays, l'incitant à envisager également de reconnaître le mouvement sécessionniste. Le gouvernement a clairement indiqué que le Cameroun est un et indivisible », explique Otto.
La position du Cameroun a été largement marquée par le silence et la prudence.
La position de l'Érythrée, en revanche, est façonnée par une histoire bien différente, ancrée dans sa propre lutte pour l'autodétermination.
En 1988, lorsque Yasser Arafat a proclamé la Palestine comme État souverain, il a eu besoin du soutien des pays africains. L'Éthiopie était l'un d'eux.
« Le siège de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à l'époque, devenue plus tard l'Union africaine, se trouve en Éthiopie, à Addis-Abeba », explique l'analyste politique érythréen Abdurahman Sayed.
« Le régime militaire éthiopien était également prosoviétique et, par conséquent, très favorable aux droits et à la lutte des Palestiniens. »
Mais l'Érythrée luttait alors pour son indépendance contre l'Éthiopie.
« De toute évidence, à l'époque, l'Éthiopie occupait l'Érythrée. Et les Érythréens étaient en lutte, armée, contre l'occupation éthiopienne », explique Sayed.
« Pour que les Palestiniens puissent établir une quelconque relation avec les Éthiopiens, ils ont dû prendre leurs distances avec les Érythréens, aux dépens de ces derniers. C'est ce qu'a fait, je pense, Yasser Arafat, ce qui n'a pas plu aux Érythréens en général, ni au président actuel », dit-il.
Cependant, le président érythréen Issaias Afwerki a manifesté sa sympathie pour la cause palestinienne et a même voté en 2012 pour accorder à la Palestine le statut d'« État observateur non membre » à l'ONU.
Mais il a également rejeté les efforts de paix comme les accords d'Oslo, qui établissaient un cadre de paix accordant une autonomie palestinienne limitée dans certaines parties de la Cisjordanie et de Gaza, comme un tremplin vers un État indépendant.
« Le président érythréen a été parmi les premiers à rejeter les accords d'Oslo en 1993, les qualifiant d'inutiles et ne résolvant en rien les causes du conflit ni la question des droits et de l'autodétermination des Palestiniens », déclare Abdurahman Sayed.
Le président Afwerki affirme ne pas être favorable à une solution à deux États.
Il pourrait toutefois ressentir une certaine résistance intérieure, car 55 % de la population de son pays est de confession musulmane.
« L'Érythrée est née de sa lutte pour l'autodétermination. Ainsi, pour quelqu'un qui a mené ou participé à la lutte pour la libération, ne pas soutenir la libération d'autres peuples est moralement inacceptable. La pression serait forte », déclare Sayed.
Maintenant que le Canada a annoncé reconnaître l'État de Palestine, le Panama fait désormais figure d'exception avec les États-Unis sur le continent américain. Interrogé par Le Parisien, le géopolitologue David Rigoulet-Roze explique que cette position est un "geste de loyauté envers l’Oncle Sam". "Les deux pays ont des liens économiques et politiques historiques qui expliquent l’alignement du Panama sur les États-Unis dans le domaine de sa politique étrangère".
Africa24monde et AFP